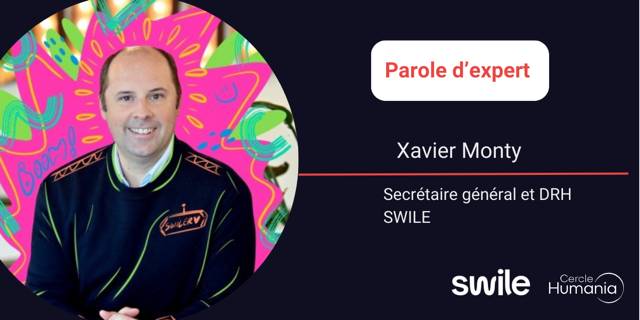Dirigeant ou DRH, nous n’avez pas forcément prévu de vous retrouver convoqué dans les bureaux de l’inspection du travail, mais la probabilité existe – et elle va même croissant, d’après les statistiques du cabinet Actance, lesquelles s’inscrivent dans la continuité des évolutions législatives* et des instructions de l’administration.** Depuis deux ou trois ans, ce pouvoir de police s’exerce plus intensément, dans un objectif affiché de responsabiliser les entreprises. Si cela vous arrive, mieux vaut savoir à quoi s’attendre et s’y être préparer !
Aymeric de Lamarzelle, avocat associé du cabinet Actance, accompagne régulièrement ses clients dans ce cadre et nous livre ses conseils pour bien réagir.
Vous alertez sur une « montée du droit pénal du travail ». Est-ce une vraie tendance ou une impression passagère ?
C’est une tendance réelle qui s’installe vraiment ces dernières années par le biais de ces auditions pénales libres menées par les inspections du travail. On assiste à une progression très nette de ce type d’auditions, qui relevaient de l’anecdotique il y a encore cinq ans et qui sont aujourd’hui six à dix fois plus fréquentes. À mon sens, cette trajectoire est liée à l’évolution des pratiques des inspections du travail et de leurs prérogatives : celles-ci ont, sous l’impulsion du Ministère et du législateur, pris à bras-le-corps leurs compétences en matière pénale.
Il suffit pour s’en convaincre de prendre connaissance de la dernière circulaire en la matière du 11 juillet dernier dont l’objet est notamment de « renforcer l’effectivité de la réponse pénale » « par une meilleure coordination des services judiciaires et de l’inspection du travail ».
Qu’est-ce qui a changé concrètement dans le rôle de l’inspection du travail ?
Leurs inspecteurs ont toujours eu un pouvoir de police. Mais celui-ci a été renforcé et clarifié dans les dernières années et aujourd’hui, ils l’exercent pleinement, encouragés à mon sens par le Ministère qui les incite à jouer activement leur rôle en matière de prévention des risques de sécurité en entreprise. Ainsi, je constate qu’ils procèdent à davantage d’auditions pénales libres, lesquelles peuvent conduire à des procès-verbaux transmis au procureur de la République.
En somme, ils assument les prérogatives d’un gendarme ou d’un officier de police judiciaire en matière d’instruction pénale. Ce n’est pas anodin et l’inspection du travail étant experte en matière de droit du travail, elle assume ce rôle de façon bien plus approfondie et stricte qu’un service de police – ce dont les employeurs doivent avoir conscience.
Cela signifie que les entreprises peuvent être convoquées et poursuivies ?
En effet. Il s’agit généralement d’infractions relevant de la qualification de délits : harcèlement moral, travail dissimulé, accidents du travail, mauvaise application du temps de travail, sous-traitance illicite, devoir de vigilance, prêt de main-d’œuvre illicite, embauche de salarié étranger en situation irrégulière, non-assistance à personne en danger, homicide involontaire…
La responsabilité pénale du dirigeant peut alors systématiquement être engagée tout comme celle du dirigeant en sa qualité de personne physique s’il a commis une faute intentionnelle notamment. Et lorsque l’inspecteur du travail estime les faits reprochés suffisamment caractérisés, il peut dresser un procès-verbal qu’il transmet au procureur de la république qui peut alors décider de renvoyer la personne mise en cause devant le tribunal correctionnel. Dès l’audition, le dirigeant est plongé dans un cadre très formel puisque l’inspection du travail au même titre qu’un officier de police va lui rappeler ses droits ainsi que l’éventualité de son renvoi en correctionnelle, potentiellement très angoissant.
Vous parlez d’un outil pédagogique. N’est-ce pas contradictoire avec cette pression judiciaire ?
C’est toute l’ambiguïté en effet. L’audition pénale libre est aujourd’hui utilisée comme un levier pédagogique par l’inspection du travail, mais sous une forte contrainte psychologique, puisque le cadre de cette audition est très formel et donc volontairement pressurisant. Le dirigeant sort souvent de l’entretien avec l’impression de s’être fait malmené ou d’être traité comme un « voyou » de droit commun. Or, pour la plupart d’entre eux, ce sont au contraire de « bons élèves », des individus très bien insérés socialement. S’entendre dire qu’on risque 75 000 euros d’amende ou un an de prison, parfois sur des faits que l’on considère comme non avérés, peut être extrêmement déstabilisant. Certains s’imaginent directement avec des menottes, alors qu’au stade de l’audition, on en est encore très loin.
Il faut comprendre que ce cadre très formel et les risques encourus sur le plan pénal permettent de faire prendre conscience aux employeurs de la nécessité de prévenir les risques et de leur rappeler la grande étendue de leurs responsabilités en la matière. C’est en ce sens que l’inspection du travail considère jouer un rôle de pédagogie.
Ce type de convocation est-il toujours précédé d’un échange avec l’entreprise ?
Pas nécessairement. Il peut y avoir un échange de courriers préalable, mais ce n’est pas la règle. L’entreprise peut être convoquée sous 8 à 15 jours, sans forcément savoir ce qu’on lui reproche. Et lors de l’audition, les questions sont très précises, fondées sur des auditions précédentes de collaborateurs ou plus globalement sur une instruction approfondie d’ores et déjà réalisée par l’inspection du travail.
C’est un cadre très formel : chaque mot est retranscrit, chaque réponse devient un acte de procédure et pourra être utilisée pour ou contre l’entreprise ou le dirigeant dans le cadre de l’éventuel dossier pénal.
Vous dites que les DRH sont en première ligne ?
Oui, et heureusement. Sans un DRH bien préparé, une entreprise est aveugle et sourde face à ces risques. Le DRH doit anticiper, mettre en place des politiques de prévention, documenter chaque action. Ce n’est pas une garantie contre l’accusation, mais c’est une défense solide et indispensable en cas de procédure si celle-ci est bien menée. La DRH est la première sollicitée en cas de crise.
À noter : face à un grand groupe, la tolérance des inspecteurs du travail est nécessairement très faible, là où une PME peut encore espérer plus de souplesse, de tolérance et d’accompagnement.
Il convient donc de bien être accompagné pour mettre en place une bonne politique de prévention des risques et de bien prendre en compte les risques psychosociaux. Ce peut être par le biais notamment de la mise à jour et l’actualisation régulière du DUERP, de veiller à régulièrement informer et faire dispenser des formations en interne principalement aux managers de proximité, aux RH, sur ces thématiques – notamment prévention des risques, responsabilité pénale des dirigeants et personnes morales : risque, prévention et préconisations, prévention des risques accidents du travail et maladie professionnelle, gestion adaptée de la sous-traitance, recours à la main d’œuvre étrangère…
Comment le code du travail évolue-t-il ?
On est passés d’une obligation de sécurité résultat à une obligation « de moyens renforcés » depuis 2016. Dans l’esprit, cela revient à demander aux employeurs : « Avez-vous mis en place des actions suffisantes pour éviter les risques ? ». La pression reste très forte et la tendance tant judiciaire que du côté de l’inspection du travail est de vouloir faire peser sur les épaules de l’employeur les éventuelles dégradations de l’état de santé des collaborateurs lorsque celles-ci présentent un lien avec le travail. Le mal-être au travail est en hausse, l’absentéisme explose. Et même si une part de ce malaise vient sans doute de problématiques personnelles, les entreprises sont en première ligne et de plus en plus challengées sur leur politique de prévention des risques.
L’affaire France Télécom a ouvert au demeurant la porte au concept de « harcèlement moral institutionnel » qui n’est pas sans conséquence sur cette tendance puisque cette notion apparait de plus en plus tant lors de nos échanges avec les inspections du travail que devant les juridictions. Il convient à ce titre, pour éviter toute confusion, de rappeler que cet arrêt concernait un cas très exceptionnel, marqué par des dizaines de suicides et une politique de pression, qui semblait aux dires de l’arrêt, assumée. Depuis, on assiste à un amalgame dangereux et une utilisation abusive de cette notion qu’il convient de remettre à sa juste place lorsqu’elle nous est opposée : toute situation conflictuelle sur le plan collectif ne peut être qualifiée de harcèlement institutionnel, notion qui ne trouve d’application qu’en cas de démonstration établie d’une politique de déstabilisation et de pression mise en œuvre au sein d’une entreprise qui, en toute connaissance de cause, conduit à la dégradation des conditions de travail de tout ou partie de leurs salariés.
De votre côté, vous évoquez des procédures contre les médecins ?
Cela nous arrive en effet d’agir à l’encontre des médecins devant leur Ordre lorsque nous considérons qu’ils violent leurs obligations déontologiques : arrêt de travail de complaisance, arrêt antidaté, mention d’un lien entre l’état de santé du patient et ses conditions de travail… En effet, pour exemple, lorsqu’un médecin traitant établit un lien direct entre l’état de santé d’un salarié et son travail, sans contradiction possible et alors qu’il ne peut avoir constaté ce lien, ne travaillant pas dans l’entreprise, il outrepasse son rôle, viole ses obligations déontologiques et encourt de ce fait une sanction. Nous saisissons alors le conseil de l’Ordre puis le conseil départemental de discipline des médecins afin de faire constater ce manquement. Il faut en effet comprendre que ces obligations déontologiques semblent parfois méconnues ou mal appréhendées par les médecins traitants et que leurs mentions sont génératrices de risques importants pour les entreprises sur le plan judiciaire.
Il est donc indispensable selon moi de faire évoluer les pratiques et ce type de recours m’apparaît indispensable pour arriver à cette fin. C’est une autre facette de cette nouvelle approche du droit du travail : une vigilance accrue sur tous les acteurs.
Quel est votre rôle, en tant que conseil ?
Ce volet du droit pénal du travail n’est pas une menace réelle dans la mesure où in fine les condamnations n’ont pas connu une explosion corrélée avec le nombre d’auditions pénales libres. C’est un outil : un outil de régulation et de responsabilisation. Il faut le comprendre, l’anticiper, ne pas le banaliser, mais ne pas le diaboliser non plus. Une audition libre ne termine pas toujours, loin s’en faut, chez le procureur et encore moins en correctionnelle. Il faut savoir simplement s’y préparer, apporter des réponses ajustées lors de l’audition, et faire valoir de façon exhaustive et formalisée les arguments de la société avant et/ou après l’audition pour défendre au mieux les intérêts de l’entreprise et de ses dirigeants !
(*) Notamment la loi n’2019-222 du 23 mars 2019 venant étendre et clarifier les pouvoirs de police de l’inspection du travail.
(**) Comme l’instruction conjointe DACG/DGT du 23 juin 2020 et une nouvelle instruction ministérielle conjointe du 11 juillet 2025 venant renforcer la politique pénale du travail et la coordination entre l’inspection du travail et les procureurs de la république dans la répression des manquements aux obligations de santé et de sécurité des travailleurs.

Florence Boulenger est journaliste et consultante éditoriale, spécialisée dans les transformations des entreprises, avec un intérêt marqué pour le numérique et le futur du travail.