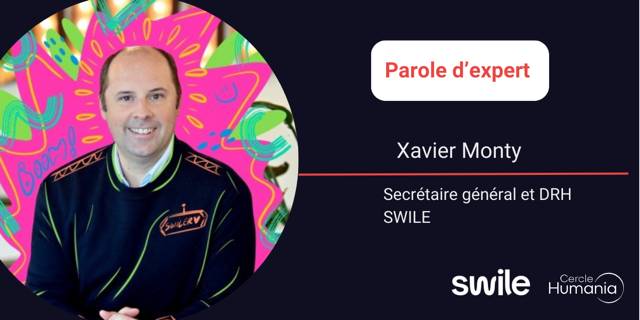Crédit Photo : Paul Carrier
« Notre pays traite volontiers le vieillissement comme une hypothèse, mais c’est une réalité », a lancé Marie-Anne Montchamp, directrice générale de l’Ocirp, avant le dévoilement des chiffres-clefs d’une étude menée par l’Institut méditerranéen des métiers de la longévité (i2ml) de Nîmes Université, sur les représentations sociales associées aux salariés seniors.le 1er octobre dernier. « C’est pourquoi nous avons souhaité lever le voile et regarder ce qu’il se passe vraiment, sur le terrain. »
En la matière, l’ESS fournit un excellent terrain d’observation, puisque comme l’a rappelé Hugues Pollastro, directeur général de l’Udes, un salarié sur trois y est un « senior » (plus de 50 ans). Soit 5 points de plus que dans le reste de l’économie. « D’après nos projections, en 2028, il faudra compter sur 500 000 départs en retraite, sur un total de 2,7 millions de salariés. »
C’est Margot de Battista, ingénieur de recherche et directrice de l’Institut méditerranéen des métiers de la longévité, qui a piloté l’étude, intitulée « ReVeS² ». Une recherche « en action », qui se déroule en trois phases : enquête, puis co-construction de solutions (une étape lancée le jour même) et enfin une analyse d’impact des premières initiatives, qui sera réalisée entre septembre 2026 et 2027.
Les répondants estiment qu’être « senior » commence à 54,4 ans. 60% indiquent qu’il n’existe pas de dispositifs dédiés au sein de l’entreprise et ce sont les plus de 55 ans qui déclarent significativement plus qu’il n’en n’existe pas. Beaucoup sont aussi des proches aidants : nous y reviendrons dans un prochain article. Dans la cohorte générale, le contenu des représentations sociales vis-à-vis des salariés seniors s’articule autour de différentes catégories « compétences et capacités, carrière, expérience », mais aussi « la vieillesse, l’âge », « la placardisation et la pénibilité », alors que dans la cohorte ESS, ni les marqueurs de l’âge ni les deux derniers items négatifs ne ressortent.
Les enquêteurs ont travaillé sur une « mesure d’association implicite », pour étudier les stéréotypes dont nous n’avons pas conscience. Les résultats sont plus négatifs que pour les mesures explicites préalablement recueillies. Il y a donc une co-existence de déclarations positives sur les salariés seniors et des stéréotypes implicites plus négatifs.
« Faire évoluer les stéréotypes est long et difficile, mais il existe deux leviers efficaces, a souligné Margot de Battista. D’abord, la sensibilisation, en rappelant notamment que c’est un phénomène polymorphe : on ne vieillit pas tous de la même façon. Ensuite, le fait de travailler en inter-génération est très pertinent pour mettre une réalité en face des idées reçues. »
Âge administratif et âge prospectif
Cette étude ReVeS² a permis d’aborder des sujets de fond, comme l’âge prospectif, sur lequel Marie-Anne Montchamp a insisté. L’âge prospectif se définit par le nombre d’années restant à vivre. « Or, dans les politiques publiques, la notion d’âge est construite uniquement sur l’âge administratif. Ce qui nous amène parfois à des situations absurdes : par exemple, si l’on devient handicapé avant d’avoir 60 ans, on est considéré comme handicapé, mais si cela arrive après 60 ans, on est juste “vieux”. »
Le dialogue social, la négociation sectorielle, permettent d’amener des propositions vraiment ancrées dans les réalités de terrain. David Cluzeau, président de l’Udes, a rappelé également l’importance d’intégrer les sujets de santé mentale. « On a beaucoup pensé posture et usure physique, mais peu pensé – ou du moins peu documenté – l’usure liée à la charge mentale. Or, dans l’ESS, où l’on est confronté à des situations difficiles, c’est capital. L’Udes demande donc à ce que dans les critères de pénibilité, on intègre des indicateurs de charge mentale. » L’Udes est la seule organisation patronale représentative des employeurs (associations, mutuelles, coopératives, fondations), soit plus de 220 000 entreprises.
Transmission et innovation
Prendre soin de ses collaborateurs dans leurs, 5, 10 (ou 15 !) dernières années d’activité, c’est aussi s’intéresser au sujet de la transmission. Pour l’entreprise, cet « héritage » légué par un salarié sortant à ceux qui restent est stratégique. Or, il est rarement étudié sous le prisme des seniors, alors que leur départ est bien plus prévisible que les autres départs liés au turn-over.
Benoît Roig, président de l’Université de Nîmes, présent à la table ronde, est pour le coup très attentif à ce « tuilage », mais il a du mal à le faire car dans la fonction publique, il ne peut embaucher qu’après un départ : « On s’appuie donc sur les contractuels, à l’exception de certains domaines où on peut demander du personnel en plus, comme la cybersécurité. » ll s’efforce aussi de faire comprendre aux plus jeunes que « la cohésion d’équipe est clef, pour que la structure fonctionne et que les savoir-faire circulent, il faut mélanger les générations. »
Marie-Anne Montchamp (Ocirp) donne d’autres exemples : « Dans nos métiers où les situations de contact, voire de confrontation avec des publics parfois difficiles, sont nombreuses, on pourrait très bien imaginer l’intervention d’un senior comme deuxième recours après le junior. Dans ce cas, le clivage entre générations s’estompe au profit d’un partenariat. Pour cela, il faut sortir de la vision rigide de la GPEC et inviter les équipes – juniors et seniors confondus – à adresser ensemble des sujets d’innovation. » L’innovation met tout le monde à égalité : « La cohésion d’équipe se fonde mieux sur la base d’un projet, que sur la base de l’emploi et des fiches de poste… »
La prévoyance, une « priorité »
Autre sujet abordé en table ronde : la prévoyance. « Elle ne peut se résumer à la complémentaire santé », ont estimé tous les intervenants. Employeurs et salariés, on consacre beaucoup d’argent à la complémentaire santé, et la prévoyance devient subsidiaire, quant à l’Ocirp on estime qu’il faut en faire une priorité : « Il s’agit de prévenir les accidents de parcours, les maladies chroniques, le fait de devenir salarié-aidant… Pour le moment, on est sur de la réparation, or on devrait passer à un niveau d’anticipation : nous avons assez de données pour savoir où il faut agir ! » David Cluzeau (Udes) a confirmé que cette vision s’inscrit pleinement dans un accord de branche, portant sur la transition démographique, qui sera signé le 8 décembre en principe.

Florence Boulenger est journaliste et consultante éditoriale, spécialisée dans les transformations des entreprises, avec un intérêt marqué pour le numérique et le futur du travail.