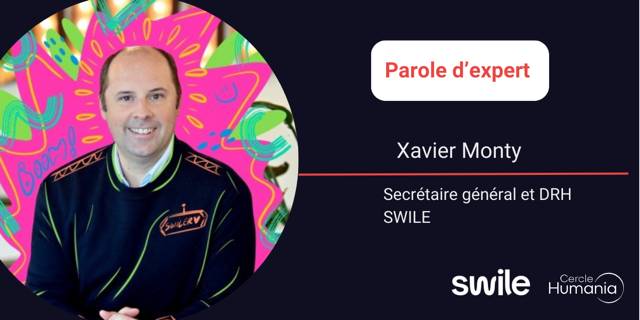Une étude Indeed & PageGroup publiée le 8 avril dernier indique que presque 60 % des salariés craignent de découvrir l’année prochaine qu’ils sont moins bien payés que leurs collègues, à poste égal. La nouvelle réglementation sur la transparence des salaires a des allures de bombes à retardement : elle pourrait faire éclore un certain nombre de conflits.
En quoi la directive européenne marque-t-elle une évolution majeure en matière de droit du travail ?
Quels sont les grands principes posés par ce texte ?
Quels défis concrets cela pose-t-il aux entreprises ?
Quelles sont les conséquences juridiques à anticiper ?
Que recommandez-vous aux employeurs pour se préparer ?
Premièrement : anticiper. Il faut absolument remettre à plat les systèmes de fixation des salaires. Très vite, la réponse « Je n’ai pas les éléments / l’historique » ne suffira plus. Il faut faire un audit, analyser les écarts, mettre en place un plan d’action. Et ce travail doit être intégré dans une stratégie globale autour des salaires : négociations obligatoires sur les salaires, accords sur les classifications, accord de GEPP…
Ensuite, travaillez sur l’égalité professionnelle. Pourquoi dans certaines entreprises 70 % des cadres sont des femmes, mais seulement 5 ou 10 % au Comex ? Promouvoir l’égalité professionnelle, c’est aussi résoudre structurellement les écarts de salaires.
Enfin, conserver les preuves, archiver les critères de fixation des salaires, sur plusieurs années. C’est contraignant, mais indispensable. D’ici 2029 ou 2030, toute entreprise devra être en mesure de démontrer précisément comment elle a fixé ses salaires. Ne pas avoir de critères clairs ne sera plus toléré. L’objectif, à terme, c’est une grille de classification des postes, associée à une grille salariale, avec des fourchettes réalistes – et pas des écarts trop larges comme aujourd’hui.
Prenez ce sujet au sérieux, et surtout, prenez-le maintenant. Ce sera beaucoup moins coûteux qu’un procès, d’autant que la tendance est déjà bien enclenchée. La directive entre en vigueur dans un an, mais il s’agit d’un sujet de fond, structurel, qui implique de repenser sa politique salariale dans la durée.

Florence Boulenger est journaliste et consultante éditoriale, spécialisée dans les transformations des entreprises, avec un intérêt marqué pour le numérique et le futur du travail.