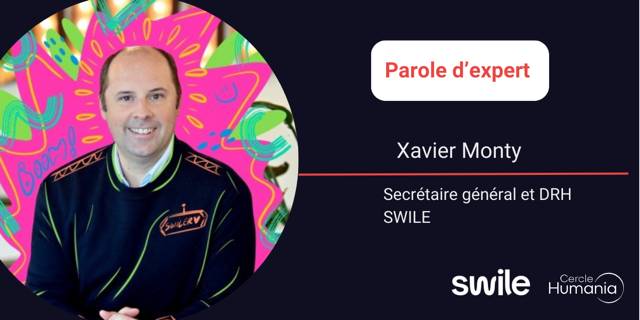Elle vient de sortir !
L’étude « La rémunération vue par les salariés du privé », signée par l’Association pour l’emploi des cadres, en partenariat avec le think tank Terra Nova, dresse un panorama complet des salaires dans le privé. C’était un travail très attendu, qui permet à chacun (employeurs et employés) de se situer sur la grille des rémunérations. Teintée d’une couleur particulière à quelques mois de l’entrée en vigueur de la directive européenne sur la transparence des salaires, elle aidera les DRH à piloter cette petite révolution.
Marion Desreumaux et Annabelle Wante, co-autrices de l’enquête, ont répondu à nos questions.
Vous avez interrogé 4 000 salariés dont 1 500 cadres, pour parler d’argent. Comment cette nouvelle étude vient-elle compléter le baromètre Apec des salaires des cadres, un grand classique annuel ?
Dans le baromètre, nous posons quelques questions sur la satisfaction des cadres par rapport aux rémunérations moyennes annoncées, mais sans aller plus loin. Nous avons eu envie de pousser le curseur du qualitatif et d’aller voir, derrière les chiffres, quelle est la perception des salariés. Le salaire qui figure en bas d’une feuille de paie ne dit rien des aspirations, frustrations ou convictions de son destinataire. Une enquête Salsa nous a inspirées (https://data.progedo.fr/studies/doi/10.13144/lil-0835). Elle date de 2009 et ses auteurs relevaient déjà à l’époque qu’il s’agissait de l’une « des rares enquêtes quantitatives qui porte sur les salaires et les jugements et représentations qui y sont associés en France. ». Il était temps de reproduire l’exercice, d’autant que la directive portant sur la transparence salariale arrive l’an prochain. Il nous a semblé important d’apporter de l’information sur ce que pensent vraiment les salariés.
Vos résultats font justement état d’inquiétudes fortes de la part des employés. Ils sont 68% à craindre une baisse de leur pouvoir d’achat et 43% à se dire insatisfaits de leur rémunération. Et-ce qui est sans doute pire pour un DRH - un salarié sur deux estime que sa rémunération n’est pas à la hauteur de ses contributions. La photo est sombre ?
Les salariés du privé formulent en effet un certain nombre de frustrations et de craintes, mais ce qui nous a surprises avant tout, c’est leur mesure et leur nuance. Il est intéressant de voir que les demandes des salariés sont précises, souvent constructives et qu’elle « matchent » parfaitement avec la Directive qui arrive.
Près de la moitié des salariés estiment que les critères de fixation des augmentations sont opaques au sein de leur entreprise (49%). Ils appellent de leurs vœux une clarification et souhaitent que les salaires d’embauche soient déterminés avant tout par les compétences requises et les conditions de travail – et les augmentations individuelles par les efforts fournis, la performance et la charge de travail. L’un des principes-clefs de la directive européenne est le suivant : « à travail de valeur égale, salaire égal ».
Par ailleurs, 64% des salariés sont favorables à ce que l’écart entre les plus bas et les plus hauts salaires n’excède pas un facteur 10. On voit bien qu’ils appellent à une forme de justice et d’équité. Or, la directive à venir imposera aux entreprises de mesurer, justifier et, si nécessaire, corriger les écarts de rémunération femmes-hommes supérieurs à 5 % pour un même travail ou un travail de valeur égale. Cette obligation ne concerne pas les écarts entre les plus bas et les plus hauts salaires, mais contribuera à renforcer l’équité salariale dans l’entreprise.
La « valeur du travail » que vous venez de mentionner fait écho à la « contribution économique du métier » que vous citez dans l’enquête. Que recouvrent vraiment ces termes ?
On peut mettre bien des choses derrière la « valeur » du travail produit et les entreprises doivent être attentives à ce sujet-là même – et surtout – parce qu’il est complexe. C’est assez facile quand on est commercial, par exemple, de définir la valeur de ce qu’on apporte à l’entreprise, mais c’est plus difficile pour les fonctions support. Pour paraître justes, les mécanismes de fixation et de progression des salaires doivent prendre en compte l’ensemble des contributions des salariés à l’entreprise : à la fois les compétences et diplômes qu’ils détiennent, mais aussi leur investissement et leur performance : des dimensions délicates à objectiver, mais centrales pour les équipes.
En parallèle de cette question de la performance, il faut aborder le sujet des conditions de travail. Aux yeux des salariés, elles sont indissociables de la rémunération, parce qu’elles contribuent à la fois à alourdir les contributions (quand il s’agit de pénibilité et de surcharge de travail) et à étoffer les rétributions, quand il s’agit de flexibilité ou d’équilibre vie professionnelle-vie personnelle. Il existe certes des réalités bien différentes au sein de chaque catégorie socio-professionnelle, voire de chaque métier, mais cette dialectique rémunérations/conditions de travail, existe partout y compris chez les cadres.
Quels autres conseils avez-vous envie de donner aux DRH qui nous lisent, au regard de ce que vous ont confié les salariés du privé ?
D’abord, quand les possibilités de jouer sur le salaire sont restreintes, l’entreprise peut valoriser tout ce qui contribue au pouvoir d’achat. Dans ce cadre, le bilan social individuel qui résume chaque année les différentes formes de rémunération et les avantages sociaux dont le collaborateur a bénéficié, peut contribuer à mettre en avant toutes ces dimensions et concourir également à l’impératif de clarté.
Ensuite, le sentiment d’un bon équilibre repose sur la rémunération, mais aussi sur la reconnaissance, l’employabilité et les conditions de travail. Ce sont des dimensions susceptibles d’offrir des leviers d’action aux entreprises, y compris lorsque leurs marges de manœuvre sur les salaires sont réduites. La formation en particulier cristallise beaucoup d’attentes de la part des salariés. Emparez-vous dès à présent de la transparence des salaires, d’abord parce que c’est une obligation légale imminente, mais aussi parce que ce sujet recoupe tous les autres et vous permettra de progresser sur tous les plans.
Les salariés du privé expriment des inquiétudes, mais évoquent-ils leur plaisir à travailler ?
Rappelons en effet pour conclure qu’on peut aimer son travail, s’y réaliser… et conserver des revendications salariales. Les deux ne sont pas contradictoires. Un signal très positif vient de l’une de nos études de l’année dernière, sur le rapport des jeunes au travail (https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/rapport-au-travail-des-actifs-de-moins-de-30-ans.html). Elle bat en brèche l’idée d’un désinvestissement des jeunes et montre la primauté des rapports positifs au travail.

Florence Boulenger est journaliste et consultante éditoriale, spécialisée dans les transformations des entreprises, avec un intérêt marqué pour le numérique et le futur du travail.